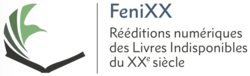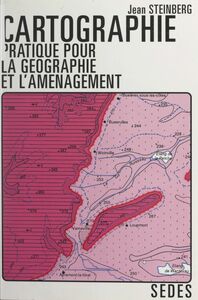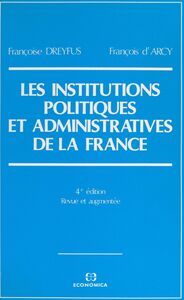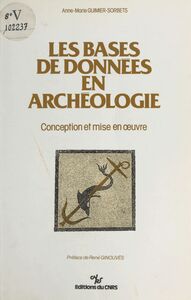
Convient-il de construire des bases de données en archéologie, dans quelle perspective, et pour quels utilisateurs ? En fonction de ces objectifs, comment déterminer les catégories d'information à prendre en compte, avec quel niveau de finesse, et sous quelle forme faut-il les analyser ? De quelles familles de logiciels dispose-t-on, pour construire et exploiter ces bases, et sur quels critères fonder son choix ? Que peut-on attendre des nouvelles technologies, et quel est l'apport des images à ces bases de données ?
L'auteur fournit des réponses à ces questions complexes, en fondant ses développements sur de nombreux exemples concrets, extraits de la vingtaine de banques de données, dont elle a assuré la conception et la mise en œuvre, pour des organismes français et étrangers.
Si cet ouvrage est destiné, en premier lieu, aux archéologues et historiens de l'art, il s'adresse aussi à tous ceux - concepteurs et utilisateurs - qu'intéressent l'automatisation de la documentation spécialisée et le traitement de l'information scientifique.
Détails du livre
-
Éditeur
-
Langue
Français -
Langue d'origine
Français -
Date de publication
-
Nombre de pages
280 -
Auteur de la préface
-
Thème
À propos de l'auteur
Anne-Marie Guimier-Sorbets
Docteur d'État en archéologie, et titulaire d'un DESS d'information et documentation de l'Institut d'études politiques de Paris, Anne-Marie Guimier-Sorbets est actuellement directeur de recherche au CNRS, et responsable du Centre de recherche sur les traitements automatisés en archéologie classique (CNRS-Université de Paris X). Chercheur et enseignant, elle a écrit une vingtaine d'articles sur les bases de données, et particulièrement en archéologie ; elle a rédigé, avec le Professeur R. Ginouvès, « La constitution des données en archéologie classique », éditions du CNRS, 1978. En 1985-1986, elle a réalisé le premier vidéodisque en archéologie, couplé à des banques de données.